Luc Brouillet a pris sa retraite. La majorité des étudiants de la deuxième année et plus (au département de sciences biologiques de l’UdeM) reconnaitront le nom de leur professeur de Biodiversité I. Certains d’entre eux, un peu plus réveillés dans ces lundis matin d’automne, ont certainement saisi la passion avec laquelle le professeur enseignait son cours. Derrière le cours, se trouve un travail homérique de reconnaissance et classification des plantes, l’oeuvre de cette encyclopédie humaine. 37 ans après avoir commencé sa carrière à l’UdeM et à l’Institut Botanique, Luc Brouillet prend sa retraite. L’été passé, son dernier comme employé officiel, un événement en son hommage a eu lieu à l’IRBV. Ses collègues et étudiants, entre taquineries et souvenirs de ses nombreuses aventures, étaient tous d’accord sur l’ampleur et l’importance de son travail au cours de ces quatre décennies de dédicacions à la taxonomie des plantes et à la défense de la biodiversité. L’herbier Marie Victorin, la Flore d’Amérique du Nord (Luc Brouillet a produit 5 des 30 volumes (plus un dernier à paraître bientôt), Canadensys et l’informatisation des données de l’herbier, en plus de ses cours au sein du département, les impressions de ses voyages et la destruction de la biodiversité… Luc Brouillet a raconté à l’ARNm un peu de sa carrière et vision de monde.

ARN messager: Si le début de vos études officielles en botanique remonte à 1972, votre passion pour la botanique a commencé beaucoup plus tôt: encore enfant, vous collectionnez déjà plantes et insectes. Aviez-vous une inspiration, quelqu’un qui vous stimulait vers cette exploration de la nature?
Luc Brouillet: Pas au début en fait, c’est plutôt amusant, c’est moi qui spontanément ai eu cette curiosité, je ne sais pas d’où c’est venu. Quand j’étais petit, en arrière de la maison il avait une grange pas trop loin, et sur un échafaudage il y avait des nids de merle entre autres, on pouvait avoir des œufs, qu’on ne touchait pas évidement, mais des choses comme ça qui attiraient l’attention vers la nature. C’est un peu comme ça que ç’a commencé. J’avais un grand-père agronome, directeur de la ferme expérimentale à l’Assomption quand je suis né, et quand il a vu mon intérêt, lorsque j’étais jeune ado, il m’a donné des livres sur la flore, que j’ai encore d’ailleurs. Parce qu’il avait été à l’école d’agriculture, il avait eu le livre du Pe. Louis-Marie, La flore – manuel de la province de Québec, et des livres sur les mauvaises herbes, et il m’a donné ces livres-là pour stimuler mon intérêt. Mais en fait je faisais ça tout seul, je ramassais des insectes, je ramassais des plantes, j’ai aussi participé un peu à des cercles de jeunes naturalistes, qui étaient pas mal encore actif à l’époque. Au secondaire, mes parents, en voyant mon intérêt, m’ont envoyé l’été au camp des jeunes explorateurs, à Saint Fulgence au Saguenay et pendant trois étés j’ai passé deux semaines avec des botanistes. À l’époque j’ai rencontré Samuel Brisson, qui était botaniste à l’Université de Sherbrook, et cette rencontre m’a stimulée et a aidé à entretenir mon intérêt. Un de mes rêves un moment donnée était de pouvoir un jour être ici, au jardin botanique, où j’étais venu avec mes parents à quelques reprises. Mais ce n’est pas vraiment quelqu’un qui m’a “entraîné”, c’est moi qui ai eu un intérêt.
J’ai fait mon bac à l’Université de Montréal, ma maitrise avec Jean-Pierre Simon, en écophysiologie végétale, après ça je suis allé à l’Université de Waterloo, où j’ai fait des études en systématique végétale, sur les asters d’Amérique du Nord. Après ça j’ai eu un emploi d’abord au collège Macdonald de l’Université McGill pendant deux ans avant d’être attiré à l’Institut Botanique par André Bouchard. Il m’a dit: “le prof qui était là vient de partir, vient-en, on a besoin de combler le poste!” Et c’est ainsi que j’ai été à l’institut depuis 1982. À l’époque, l’Institut botanique était seulement un nom sur la pierre, il n’y avait pas de lieu spécifique, c’est dans le département de sciences biologiques que j’ai commencé ma carrière à ce moment-là.
ARNm: Quel a été votre premier défi?
LB: Devoir relancer l’Herbier Marie-Victorin (HMV), qui avait été laissé un peu à lui-même par mon prédécesseur, pas celui immédiatement avant moi, mais le monsieur qui était là avant.
André Bouchard avait été engagé en 75, à la fois comme conservateur du jardin botanique et comme professeur d’écologie au département. Avec Jean-Pierre Simon, c’était les deux premiers écologistes à plein temps qu’on avait engagé au département. André avait une double tâche: relancer la recherche au jardin botanique et faire que l’institut botanique puisse se redévelopper. Quand je suis arrivé, en 1982, il m’a dit qu’il y avait un autre herbier au jardin botanique, qui était séparé de l’HMV et qui était plutôt mort depuis le décès de Mr Marcel Raymond (un très grand botaniste, qui avait travaillé avec Marie-Victorin du début jusqu’à 1970), et alors on l’a intégré à l’herbier Marie-Victorin: c’est une des premières tâches qu’on a faites. J’avais déjà un collaborateur à cette époque-là, Stewart Hay, qui avait commencé à travailler en 1980 pour maintenir l’herbier, faire des prêts quand les gens nous demandaient, des choses comme ça.

Au cours du temps on a acquis plusieurs collections: celle de l’UQAM, beaucoup de collections des collèges ou des CÉGEPs, surtout de la région de Montréal. On a aussi accueilli la collection du service de la chasse de de la pêche de Montréal, parce qu’il a eu un bon botaniste qui faisait beaucoup de plantes aquatiques et milieux humides, une collection quand même remarquable. La plus grosse avancée dans les années 80 a été l’arrivé de la micro-informatique, c’était une grosse nouvelle pour nous de voir rentrer les premiers ordinateurs: autour de 1987 on a commencé à faire l’informatisation de l’herbier. La première chose qu’on a fait c’était identifier les plantes rares pour le ministère de l’environnement, avant qu’ils puissent mettre en place en 1989 la loi de conservation des espèces en danger.
ARNm: Votre cours de Floristique du Québec était un “must-do” pour tous les gens qui s’intéressent à la biologie végétale et la flore, pouvez-vous nous en parler?
LB: La floristique a été mon premier cours. Il a fallu que je le monte, je pense c’est un des seuls cours au département qui permet concrètement à un étudiant de pouvoir trouver un job parce qu’il possède cette expertise là en sortant du bac. Ce cours donne un outil de plus: la plupart des évaluations d’impact en environnement demandent qu’on connaisse les plantes, ce n’est pas juste ouvrir le livre de la flore et identifier une plante, ça demande un peu plus de connaissances. J’ai connu plein de monde qu’ont travaillé dans ce domaine-là parce qu’ils ont suivi ce cours-là. Et pour le département je trouve que ce cours-là est super important, que ce soit moi qui le donne ou quelqu’un d’autre, peu importe. C’est tellement important qu’il y a même des amateurs ou des consultants professionnels qui donnent des formations en floristique pour des gens qui sont dans le domaine, pour qu’ils puissent avoir cet outil, des cours de quelques heures, tandis que le nôtre c’est toute une session.
ARNm: La Flore de l’Amérique du Nord est une des vos plus importantes réussites et une oeuvre d’une ampleur incroyable, comment avez-vous embarqué dans ce projet?:
LB: Je travaillais sur le groupe des Asters. Dans les années 80, en faisant des expéditions, on avait séparé deux espèces que les gens avaient mis en synonymie, des espèces endémiques au Québec: l’Aster du golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) et l’Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense). Cela grace à des travaux de mes étudiants et des observations que j’avais fait sur le terrain. Il y avait beaucoup de travaux scientifiques qui se faisaient avec des étudiants où on ramassait du matériel à travers toute la province ou même en dehors C’était mon programme de recherche plus au moins personnel. Mais en 1984 un autre projet est arrivé, celui de la Flore de l’Amérique du Nord.


Ce projet était une belle opportunité de relancer l’Herbier Marie Victorin qui était un peu tombé aux oubliettes. Il fallait des gens qui connaissent toutes les régions d’Amérique du Nord, le Canada inclus, alors je me suis porté volontaire. Ils ont accepté, et je travaille sur ce projet depuis 1985. C’est une grosse encyclopédie dont j’ai produit 5 volumes et je travaille sur un sixième à paraître prochainement, je suis probablement l’éditeur principal responsable de la publication. Ça prend beaucoup de temps, je publie moins d’articles scientifiques parce que juste éditer représente beaucoup de travail.

Le dernier volume sur lequel on travaille encore est celui qui va comprendre les érables et le groupe des Ombellifères, comme les carottes, un gros groupe qui n’est pas si connu que ça. E Juste pour faire un point là-dessus, présentement, des gens qui connaissent bien un groupe compliqué, même au niveau du continent, il n’en a pas tant que ça: la botanique traditionnelle a un peu été délaissée pendant un temps. Beaucoup d’études maintenant sont faites sur tout un groupe de la flore mondiale: un exemplaire de chaque espèce est prit et on en fait la phylogénie moléculaire, des choses comme ça, mais ces chercheurs ne les connaissent pas autant sur le terrain. Alors les connaissances pour pouvoir décrire une flore de façon compétente, d’une dimension continentale, les gens sont moins nombreux. Mais on ne peut pas perdre cette expertise-là. Tout à l’heure quelqu’un m’a apporté un pissenlit dans un pot, et c’est une espèce inconnue dans le continent! C’est moi qui avais fait les pissenlits pour la Flore d’Amérique du Nord, et je suis convaincu que c’est une espèce qui n’avait pas été décrite à ce moment-là, je ne la connaissais pas.
Il n’y a plus beaucoup de gens capables de reconnaître et d’identifier les nouvelles choses que l’on découvre.. Au Québec, par exemple, il y avait plusieurs herbiers auparavant, et il reste seulement ceux de McGill, de l’université de Montréal et de l’université Laval, plus l’herbier du ministère de l’agriculture à Québec. Ce sont des assez gros herbiers, mais avant il y avait plus d’herbiers régionaux, et les universités n’ont plus intérêt à les garder. Pourtant, c’est un outil de travail important.
Par exemple, pour Le projet CABO d’Étienne Laliberté, toute la documentation de tous les spécimens qu’ils génèrent pour lire des spectres des feuilles pour les identifier est déposée à l’herbier après pour qu’on soit sûr que l’espèce sur laquelle ils ont travaillé est bien la bonne. Cette documentation scientifique là est importante et fait encore partie du rôle de l’herbier.
ARNm: L’enseignement, comment voyez-vous ça?
LB: Vers la fin de ma carrière, fin des années 2000, j’ai eu le plaisir, si on peut ainsi dire, d’enseigner le cours de première année Biodiversité 1, ce qui était une nouvelle expérience pour moi. C’est un cours apeurant pour les profs, tu es devant 180 étudiants, il faut que tu leur donnes de la matière qu’ils ne connaissent pas du tout, parce que tu n’as pas d’introduction à ça au CÉGEP, et on donne tous les groupes sauf les animaux, alors on se retrouve avec des groupes qu’on connaît mal, c’était un défi particulier. Je pense que j’ai réussi, initialement avec Mohamed Hijri, après tout seul, à rendre ça un peu digestible quand même pour qu’au moins les étudiants aient une notion de base avant de passer à d’autres choses.
ARNm: Vous ne trouvez-pas que c’est un cours avec un peu trop d’apprentissage par coeur?
LB: On a un peu une aversion pour l’apprentissage par cœur, aujourd’hui, les gens me disent “je peux trouver tout ça sur Wikipédia”. Mais pour être capable de trouver sur Wikipedia il faut savoir quand même,quelque chose: par où commencer. Il faut connaitre un nom, que ce soit le nom vernaculaire, le nom scientifique, un nom de groupe au moins. Et pour les grands groupes, les classifications ne sont pas totalement fixées, il y a plusieurs noms, plusieurs classifications qui circulent en même temps, c’est compliqué pour moi et c’est compliqué pour les étudiants quand ils vont par eux même chercher la littérature scientifique. Notre but dans ce cours là c’est justement de donner des outils pour être capable d’entrer dans le domaine. Vous ne retiendrez pas le cycle de vie de la Paramécie, je ne m’attends pas à ça, vous allez l’avoir vu, vous savez que ça existe, que c’est un organisme unicellulaire et qu’aujourd’hui la classification des unicellulaire est beaucoup plus complexe qu’elle n’était au 19eme siècle. Donc juste de savoir ça pour moi c’est une victoire. C’est sûr que les noms, on les oublie. Quand je donnais le cours de taxonomie des plantes, les étudiants ne se souvenaient pas toujours, mais ils avaient la base, ils savaient ce qu’était une fougère. Par contre quand j’avais des étudiants d’autres domaines dans mon cours, qui n’avait pas eu Biodiversité 1, j’ai dû recommander de lire le livre de Raven pour qu’ils aient au moins une petite notion. Quand tu arrives après ça dans des cours de parasitologie ou d’autres cours comme ça et que tu as vu tous les groupes, tu as une idée d’où les attacher. Alors c’est ça le but du cours: quand vous allez les chercher après, vous avez au moins un mot pour commencer quelque part et à partir de ça tu peux te retrouver.
ARNm: Il y a cette idée que les chercheurs n’aiment pas trop enseigner… qu’en pensez-vous?
LB: Je dirais que la majorité de mes collègues, même ceux qui sont moins confortables avec l’enseignement qu’avec la recherche, ont quand même un certain goût d’enseigner. Surtout qu’à l’Université de Montréal on n’a pas le choix. Je trouve important que les professeurs enseignent au premier cycle, parce que, pour les étudiants, quand c’est un professeur à la place d’un chargé de cours, ils ont en face d’eux la personne qui est en train de développer ce champs de recherche là. Même si parfois on est obligé d’enseigner des choses sur lesquelles on n’étudie pas, je ne faisais pas de recherche sur la Paramécie. Mais enseigner, ce que ça te force à aller voir si cette connaissance-là n’est pas en train d’évoluer et de la mettre à jours continuellement. Des fois j’apprends des choses juste avant de les enseigner. Je trouve que c’est important que les étudiants aient, au moins pour la majorité de leurs cours, de véritables professeurs. Et pas parce qu’ils sont meilleur en pédagogie, des fois c’est vrai, des fois ce n’est pas vrai, mais parce qu’ils vont avoir un cadre où ils sont capables de mettre à jour leur connaissances, et comme ça vous ne serez pas un siècle en retard quand on vous donne la matière. Un chargé de cours n’est nécessairement pas plongé dans le sujet, alors des fois il vont suivre un bon manuel, et ça va prendre plus de temps avant qu’ils intégrent la recherche récente, tandis que nous on est continuellement dans ce bain-là.
Le dernier cours que j’ai enseigné, c’est un cours de deuxième cycle, le seul cours du département dans le programme d’environnement et développement durable. Maintenant c’est Pierre-Luc Chagnon qui le donne, c’est le cours de Gestion de la Biodiversité. J’aimais beaucoup la façon dont je l’avais proposé, avec Anne Bruneau : on invitait des gens qui travaillaient en gestion dans les ministères, dans les municipalités, des fois dans d’autres domaines qui avaient affaire avec la gestion de la biodiversité, pour parler concrètement de leur façon de faire, dans les parcs du Québec, les parcs fédéraux. Par exemple, comment un gestionnaire en agriculture fait-il pour conserver la biodiversité?
ARNm: Justement, comment voyez-vous cette relation entre développement et préservation? Est-ce qu’il y a un équilibre possible de développement durable?
LB: À la longue, le concept de développement durable, c’est bien beau, mais je ne crois pas qu’il contribue vraiment dans la préservation de la biodiversité. Ça ne va pas freiner la perte de biodiversité. Je vais être un peu cynique ici, je crois que la commission Bruntland avait fait un rapport en réaction sur le fait qu’il avait beaucoup de demande de la part des écologistes au plan mondial, au début des années 1980, pour préserver la biodiversité, pour préserver la forêt amazonienne, pour préserver les choses dans tous les pays. Cette pression dérangeait le milieu économique, énormément. Et je pense que ça n’a pas changé. Le discours de notre gouvernement et du parti d’opposition à Ottawa sont clairs là-dessus. On entend encore des maires nous dire “ben là on n’est pas pour avoir une ‘tite grenouille nous empêcher de faire du développement”… et là récemment on voit des inondations: on construit dans une forêt humide, dans des marécages, on les assèche et on fait des murs pour éviter un envahissement, mais ça reste dans le lac. Ça fait partie de l’écosystème du lac, ça ne devrait pas appartenir à la municipalité, surtout dans un grand cours d’eau. Mais ils ont envahi ça aussi. Et ils veulent qu’on continue à payer pour les dégâts après. Ça ne marche pas, ce sont des habitats riches qu’on détruit à chaque fois.
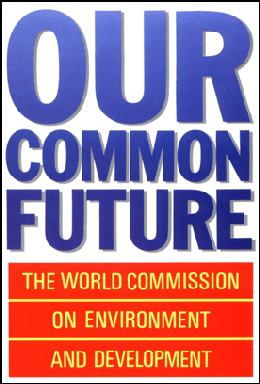
Mon constat c’est que le développement durable a plutôt été utilisé pour dire aux gens “ce sont des gens pauvres alors il faut les laisser faire” donc on continue à détruire la biodiversité, dans les pays pauvres surtout. Et l’autre discours que j’ai entendu c’est “c’est du développement durable”, mais c’est du développement économique, et pour la partie durable on fait des parcs dans le nord du Québec,mais pas dans le sud du Québec, là où c’est difficile à faire parce que tout est privé. C’est difficile de faire de la conservation dans les plaines du Saint-Laurent, dans l’écoumène québécois. Moi, je ne suis pas convaincu, avec l’étalement urbain continu, que la population québécoise est plus écologique que tout autre population ailleurs dans le monde. On continue, à part des petites décisions économiques personnelles, à s’étaler, à aller sur des milieux, à vouloir faire un parking de plus, un centre d’achat de plus, un autre développement, sans penser qu’il aura des répercussions, que peut-être à la prochaine tempête on n’aura plus d’habitats pour absorber l’eau qui va déborder.

Il faut qu’il y ai une prise de conscience, parce qu’on ne peut plus se permettre de dire qu’on va sauver un 10% et que ça va être suffisant, ce qui était toujours le discours qui oubliait que 90% avaient déjà été détruits. Alors on sauve 10% du 10% qui reste? 1%? Ou on sauve tout le 10% qui reste? C’est là qu’on est rendu.
Tout est très facile à détruire, mais c’est très difficile à reconstruire après, parce qu’il faut refaire des lois, et abréger une loi est plus facile que d’en créer une.
Autant je suis très fier des jeunes du secondaire, CÉGEP, université, qui luttent pour le climat, autant il faudrait faire le même mouvement, en même temps, pour la biodiversité. Il n’y a pas suffisamment d’éducation sur la biodiversité dans les écoles selon moi. La biodiversité se perd parce qu’on modifie et on détruit les habitats, parce qu’on surpêche, on surchasse, qu’on coupe trop de bois. Je n’ai jamais vu une protestation parce que les chinois allaient tuer des tigres, mais j’ai vu pour les phoques au Canada par exemple, qui n’était pas en danger. Je trouve ça un peu incohérent de la part des groupes écologistes.
ARNm: Parlons du futur: qu’est-ce vous pensez faire maintenant?
LB: Je veux faire un peu de bénévolat. Au début je voulais aller à Madagascar, mais mon étudiant de Doctorat, qui est Malgache, est venu au Canada, tellement la situation est difficile là-bas sur certains côtés. Madagascar, c’est une histoire de cœur, et c’est aussi une faune et une flore qui sont en train de se détruire rapidement, et qui est absolument extraordinaire, très unique.
Je voudrais aussi faire des choses auprès des petits, la lecture ou quelque chose comme ça. Je vais aussi continuer à travailler à l’herbier, mais pas comme conservateur, je ne veux rien d’administratif. Le travail avec les bases de données et identifier les spécimens, tant qu’on va pouvoir se promener et voir des plantes, on va pouvoir en récolter, les identifier et faire des bases des données pour qu’on puisse bénéficier de la ressource incroyable qu’est l’herbier Marie Victorin. La mise des données dans cette base (sur Canadensys) est ce qui fait que les spécimens de l’herbier redeviennent utiles à toute la communauté. Tout le monde est capable d’aller chercher les données sur le net, et savoir s’il y a une plante rare dans leur coin, savoir qu’est-ce qui est importante à préserver dans une région.
ARNm: Merci, Luc Brouillet, pour vos témoignages. Et merci de nous avoir apporté votre savoir au département de Sciences Biologiques de l’Université de Montréal. Maintenant, nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite de vos aventures!






